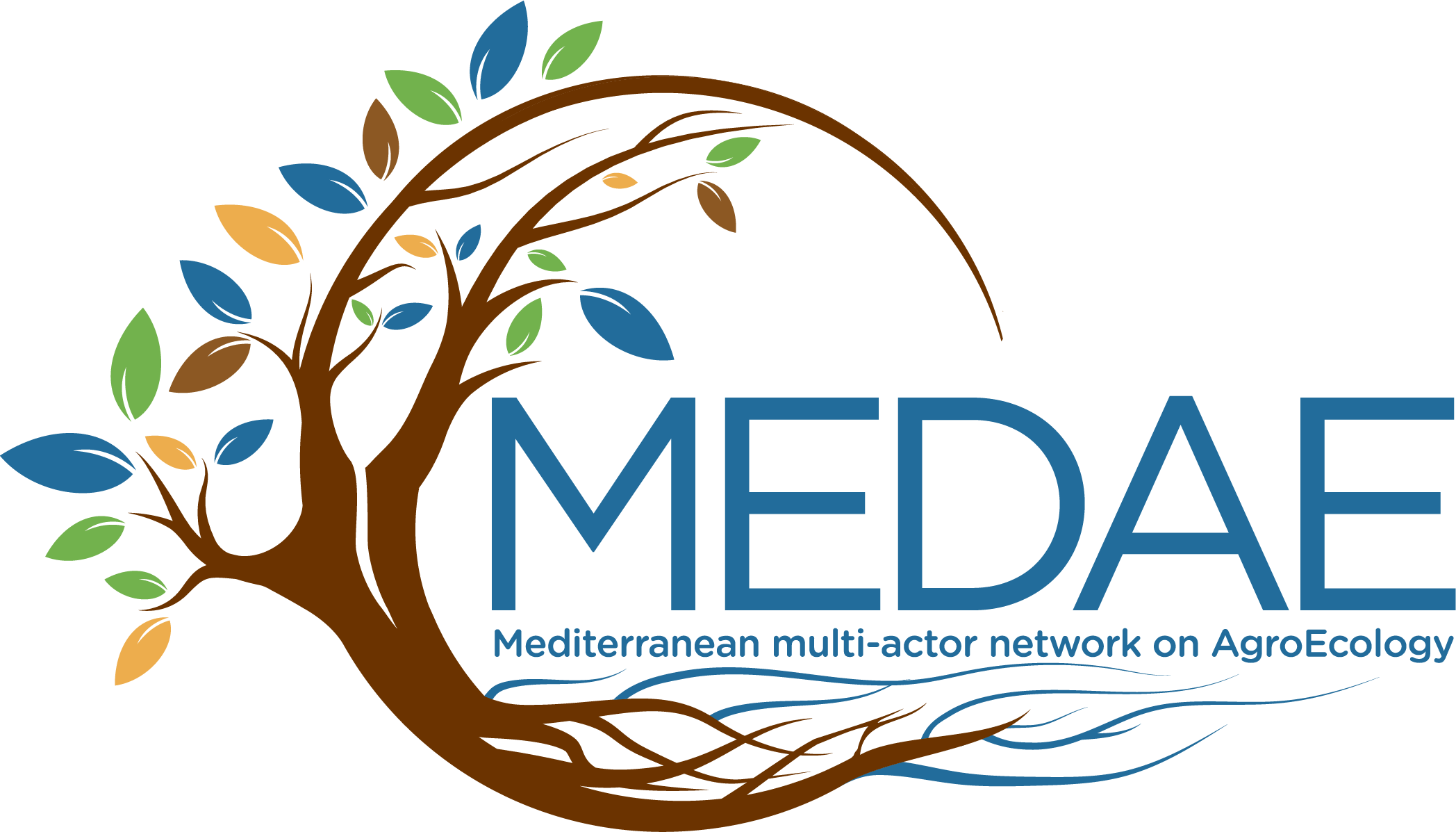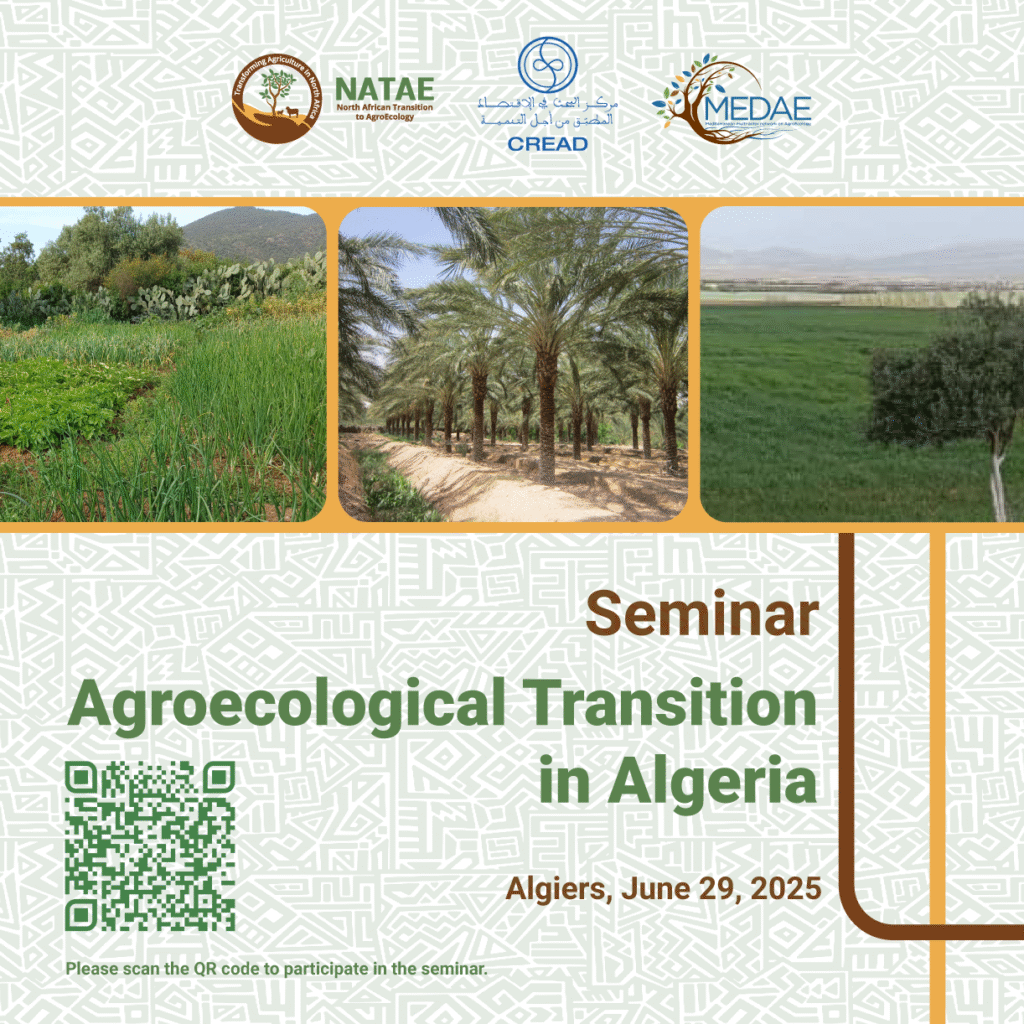
Transition agroécologique dans les différents écosystèmes pour la lutte contre le changement climatique en Algérie : réflexions autour d’une approche multi-acteurs
Alger, le 29 juin 2025
Le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD) et le réseau multi-acteur d’agroécologie en Méditerranée (MEDAE) ont organisé un séminaire sur « Transition agroécologique dans les différents écosystèmes pour la lutte contre le changement climatique en Algérie : réflexions autour d’une approche multi-acteurs ». Le séminaire a vu la participation de partenaires du projet NATAE mais aussi des professionnels de l’agroécologie (agriculteurs, réseaux et organisations), des représentants de l’administration agricole, de l’enseignement supérieur, des chercheurs et des agents de développement ainsi que des représentants des médias.

Le séminaire a été séquencé en trois sessions. La première traite de l’agroécologie dans différents agrosystèmes de l’Afrique du Nord, la deuxième est consacrée au témoignage d’un panel de professionnels en agroécologie (agriculteurs, réseaux et associations) et la troisième aux politiques et programmes pour la transition agroécologique.
Session 1 : L’agroécologie dans différents agrosystèmes de l’Afrique du Nord
Cette session, animée par Amel Bouzid, directrice de la division agriculture, territoire et environnement au CREAD, a été dédiée à des communications qui abordent l’agroécologie dans la région Afrique du nord à travers le prisme du projet NATAE. Mélanie Requiers-Desjardins a présenté le projet qui est consacré à la transition agroécologique en Afrique du Nord. Ce projet s’appuie sur l’outil des living lab déployés sur 7 sites en Afrique du nord (Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte et Mauritanie), sur quatre types d’agrosystèmes : oasien, montagneux, céréaliers et périurbains et cinq replicants lab dans des localités avec les mêmes agrosystèmes. L’approche multi-acteurs et l’approche participative ont été adoptées pour le diagnostic territorial, les expérimentations de pratiques agroécologiques et l’élaboration de scénarios de transition agroécologique. Des résultats encourageants commencent à être perceptibles par rapport à l’adoption des pratiques agroécologiques et sur l’existence d’écosystèmes locaux capables de porter cette forme d’agriculture qui est capable de garantir la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et de la santé humaine.
Le réseau multi-acteurs sur l’agroécologie en Méditerranée (MEDAE) créé dans le cadre du projet NATAE a été présenté par Rita Jalkh, membre de l’executive board du projet. Ce réseau vise à créer une communauté de connaissances et de renforcement des capacités et à poursuivre les échanges et les collaborations au-delà et après le projet NATAE. La présence d’organisations de l’écosystème de l’agroécologie visait à susciter leur intérêt pour intégrer le réseau.
Les premiers résultats du projet NATAE sont illustrés dans les présentations suivantes. Celle de Karima Boudedja, chercheur au CREAD et leader du living lab de Tizi-Ouzou, en Algérie, pour l’agrosystème montagneux, a abordé la concrétisation de la méthodologie et a abouti à l’élaboration de scénarios de transition agroécologiques qui ont intégré les pratiques agroécologiques expérimentées, dans le cadre du projet, mais aussi des aspects de gouvernance et de structuration des chaines de valeurs : la facilitation de l’accès aux ressources notamment la terre, le renforcement des compétences par le biais de la formation et l’organisation des agriculteurs et agricultrices par le biais de la création de coopératives. Souad Benmoussa, experte au living lab de Laghouat, en Algérie, dominé par l’agrosystème oasien et péri-oasien a signalé le déclin et la surexploitation des eaux souterraines dans le système oasien et la faible productivité et dépendance aux intrants du système péri-oasien. Des stratégies sont mises en place dans le cadre du projet pour, aussi bien limiter les effets climatiques, que ceux de l’agriculture intensive et pour la préservation des ressources naturelles (sol et eau). L’agrosystème céréalier est sans doute d’une importante stratégique pour les pays de l’Afrique du Nord. Le living Lab de Siliana en Tunsie a fait l’objet de la présentation de Mehdi Benmimoune, enseignant chercheur à l’INAT et membre de l’Executive board du projet NATAE. La dégradation des sols en raison des labours profonds, du morcellement des terres et de la monoculture, ont été identifiés comme des problèmes à redresser au cours du diagnostic territorial. Des combinaisons de pratiques agroécologiques : zéro labour, association de cultures, rotations, ont été testées chez des agriculteurs et commencent à être adoptés par les agriculteurs du territoire.
Après les présentations, le débat a été très riche et les questions ont concerné les outils méthodologiques utilisées dans le projet et auquelles Mélanie Requier-Desjardins a apporté des éclaircissements quant à leur adaptation aux contextes locaux des living lab. Les autres intervenants ont profité du débat pour s’étaler plus sur l’identification des combinaisons de pratiques agroécologiques testées et les macanismes mis en place pour assurer la diffusion et la durabilité de ces pratiques.




Session 2 : Le panel de professionnels en agroécologie
Aissa Belhadi, chercheur au CREAD, a animé cette session. Les panélistes ont partagé leurs diverses expériences avec l'agroécologie. Certains ont découvert l'agroécologie en adoptant des méthodes de production qui préservent la santé des consommateurs. C'est le cas de la Torba à Alger, l'association Tarwa Iakourene à Yakourene, Tizi Ouzou, et l'association des El Argoub à Laghouat. D'autres, comme les agriculteurs tunisiens Imène Chebli et Anouar Boubakri, ont hérité de ce mode de production. Imène Chebli attribue aux conseils de sa grand-mère son immersion dans les pratiques agroécologiques. Anouar Boubakri a appris directement par l'expérience, en grandissant dans une famille d'agriculteurs et d'éleveurs. L'agriculteur tunisien Amin Ben Abdallah est l'exemple même de quelqu'un qui a choisi l'agroécologie comme mode de production. Il s'est engagé dans cette voie dès le début de sa carrière agricole. Il s'est imprégné des principes de l'agroécologie, démontrant ainsi son engagement pour ce mode de production. Il a contribué à la création du Réseau tunisien pour la transition agroécologique (RTTA). Un autre témoignage est celui d'un agriculteur et ancien cadre du secteur agricole à Sétif, à 350 km à l'est d'Alger. Dans son témoignage, il explique que l'idée lui est venue. Lors d'un voyage en Tunisie, il a découvert l'agriculture sans labour et ses rendements supérieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle. Après avoir testé le semis direct sur ses propres terres, il est devenu un fervent défenseur de cette pratique et fait tout son possible pour convaincre les autres, même s'il reconnaît que l'adoption de cette méthode est mitigée.
 Enfin, il ressort des expériences des différents membres du panel que le rôle du mouvement associatif est crucial dans la diffusion des pratiques agroécologiques.
Enfin, il ressort des expériences des différents membres du panel que le rôle du mouvement associatif est crucial dans la diffusion des pratiques agroécologiques.
Malgré quelques contraintes soulevées par les membres du panel notamment les difficultés d’accès à la terre (surtout pour les femmes) ; l’absence de certification (label); la difficulté de gérer la flore adventice ; la règlementation qui peut être contraignante surtout dans le cas de la multiplication des semences paysannes ; le manque de matériel agricole adéquat, les membres du panel sont optimistes en raison de la demande croissante des produits agroécologiques et l’intérêt de différents partenaires : chercheurs, administrateurs, techniciens à cette forme d’agriculture.
Session 3 : Politiques et programmes pour la transition agroécologique
Cette session, animée par Amine Oulmane, chercheur au CREAD, a été consacrée aux politiques et programmes de développement des formes de l’agriculture alternatives pour la lutte contre le changement climatique en Algérie : agriculture biologique, agriculture de conservation et agroécologie, y compris les efforts déployés en termes de formation et renforcement des compétences, mais aussi de conseil agricole.
La première communication a été présentée par Naima Bouras, sous directrice de l’agriculture biologique et de la labellisation au Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche. Elle a mis en exergue les programmes dont les objectifs s’accordent avec les principes de l’agroécologie, sans pour autant qu’il y ait un programme clairement déclaré comme tel. La préservation des ressources eau et sol est clairement prioritaires et se concrétise par le programme de promotion des dispositifs d’irrigation économe en eau et le programme du barrage vert contre la désertification et la conservation des sols. Alors que la préservation du patrimoine génétique et des semences locales fait partie des objectifs du programme de labellisation et de différenciation des produits. La deuxième communication assurée par Lydia Chaou de l’Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC) a été dédiée au programme de l’institut pour pallier aux effets des changements climatiques de la production céréalière notamment l’aridité. L’institut travaille sur les variétés de semences adaptées aux différentes zones agroécologiques et des pratiques qui limitent la dégradation des sols et l’utilisation des engrais chimiques. Le dispositif de conseil agricole public intègre les thématiques des formes d’agriculture alternative dans les programmes des institutions publiques de conseil agricole. Mohamed Abdelmoutaleb, directeur adjoint de l’Institut National de la Vulgarisation Agricole (INVA) a présenté les canaux et moyens déployés (programmes radiophoniques, séances de démonstration, formations des agriculteurs) pour diffuser des thématiques en cohérence avec les programmes présentés par Naima Bouras. La conclusion tirée est qu’une marge de progression reste possible et que les programmes de recherche comme le projet NATAE peuvent constituer une source de résultats à diffuser en termes de pratiques et principes de l’agroécologie. Le même constat peut être fait pour la formation agricole. Brahim Bouchareb a présenté l’intégration de l’agroécologie dans les programmes de formation de l’enseignement supérieur et professionnel en agriculture. Même si celle-ci évolue, là également une progression est possible et la coopération internationale peut jouer un rôle, grâce aux projets de recherche et les projets de développement pour combler le retard dans ce domaine.


Le débat a permis d’apporter plus de précision sur les programmes abordés et sur la nécessité de coordonner les efforts des acteurs, et donc l’adoption d’une approche multi-acteurs, pour permettre la mise en œuvre efficace et durable de l’agroécologie, selon les solutions adaptées aux agrosystèmes et aux contextes locaux.